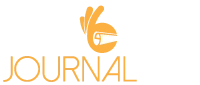Imaginez un instant la nécessité de comprendre un texte complexe rédigé dans une langue inconnue. Autrefois, la traduction automatique (TA) engendrait des résultats souvent incompréhensibles, voire surprenants. Aujourd’hui, grâce aux avancées du Traitement du Langage Naturel (TLN), les outils de TA produisent des textes bien plus fluides et précis. « Le chien est sur le tapis » traduit approximativement par « The dog is on the carpet » il y a quelques années, bénéficie désormais d’une traduction quasi-parfaite et contextuellement appropriée. Cette évolution spectaculaire est le résultat d’une révolution technologique en marche, propulsant la TA vers de nouveaux sommets, et ouvrant des perspectives novatrices pour la communication interculturelle et l’accès à l’information.
Nous allons examiner comment le TLN, en intégrant des modèles statistiques de pointe et des réseaux neuronaux sophistiqués, a transformé la manière dont les machines traduisent, leur permettant de mieux saisir le contexte, les nuances et les subtilités du langage humain. Enfin, nous aborderons les enjeux éthiques relatifs aux biais potentiels des données d’apprentissage et la nécessité de maintenir un contrôle humain sur la TA pour garantir la qualité et l’équité des traductions. Découvrez comment cette synergie homme-machine ouvre de nouvelles voies dans le domaine de la traduction et de la communication.
L’évolution de la traduction automatique grâce au TLN
La traduction automatique a connu une transformation radicale grâce aux progrès significatifs du Traitement du Langage Naturel. Au cours des dernières décennies, nous sommes passés d’une approche basée sur des règles rigides à des modèles statistiques perfectionnés et, plus récemment, à des réseaux de neurones profonds capables de discerner le contexte et les nuances du langage. Cette évolution a conduit à une amélioration notable de la qualité des traductions, ouvrant de nouvelles voies pour la communication interculturelle et l’accès à l’information. Les sections suivantes détaillent ce parcours, en explorant les différentes approches qui ont jalonné l’histoire de la TA.
TA basée sur des règles (RBMT) : un paradigme révolu
La traduction automatique basée sur des règles (RBMT) a constitué la première approche prédominante dans le champ de la TA. Elle s’appuyait sur l’emploi de dictionnaires bilingues et de règles grammaticales et syntactiques pour traduire des textes d’une langue à une autre. Le système analysait la structure grammaticale de la phrase source et appliquait des règles préétablies pour générer une traduction dans la langue cible. Cette méthode offrait un certain degré de contrôle et de prévisibilité, mais elle était entravée par la complexité de la construction et de la maintenance des règles. La RBMT éprouvait des difficultés à gérer l’ambiguïté et les exceptions, ce qui occasionnait souvent des traductions littérales et artificielles. Les expressions idiomatiques et les tournures de phrases complexes représentaient des obstacles majeurs.
- Fonctionnement : Utilisation de dictionnaires bilingues et de règles grammaticales.
- Avantages : Contrôle aisé et modification des règles.
- Inconvénients : Complexité de la construction et de la maintenance, difficulté à gérer l’ambiguïté.
Par exemple, la phrase « Il pleut des cordes » subirait une traduction littérale en anglais, perdant ainsi le sens de l’expression idiomatique. Le manque de flexibilité et l’incapacité à appréhender la richesse et la complexité du langage humain ont contribué à l’abandon progressif de la RBMT au profit d’approches plus avancées. Cette méthode s’avérait particulièrement inefficace pour les langues dont les structures grammaticales diffèrent considérablement. Les performances de la RBMT étaient généralement insatisfaisantes pour les textes longs et complexes, limitant son application pratique.
TA statistique (SMT) : l’avènement des probabilités
La traduction automatique statistique (SMT) a marqué une phase déterminante dans l’évolution de la TA. Au lieu de se fonder sur des règles prédéfinies, la SMT utilise des modèles statistiques appris à partir de vastes corpus bilingues. Le système examine les correspondances entre les mots et les phrases dans les deux langues et calcule les probabilités de diverses traductions. L’approche statistique a rendu possible une meilleure gestion de l’ambiguïté et des variations linguistiques, ce qui a mené à une amélioration significative de la qualité des traductions. La SMT a inauguré l’ère de l’apprentissage automatique dans le domaine de la TA.
Par exemple, la phrase « Je suis allé à la banque » peut revêtir deux sens : un établissement financier ou le bord d’une rivière. La SMT, en analysant le contexte de la phrase, peut déterminer la signification la plus plausible et opter pour la traduction appropriée. Cependant, la SMT nécessitait de vastes quantités de données pour la mise au point des modèles, et peinait à saisir le sens et le contexte de façon approfondie. Pour certaines langues, en particulier celles disposant de peu de ressources textuelles, les performances de la SMT demeuraient limitées. La SMT a dominé le domaine de la traduction automatique pendant une dizaine d’années, mais elle a par la suite été supplantée par la TA neuronale.
- Fonctionnement : Analyse statistique de corpus bilingues, modélisation probabiliste.
- Avantages : Apprentissage automatique, meilleure gestion de l’ambiguïté.
- Inconvénients : Nécessite de vastes quantités de données, difficulté à cerner le contexte.
TA neuronale (NMT) : l’ère de l’apprentissage profond
La traduction automatique neuronale (NMT) représente la dernière génération de technologies de TA. Elle tire parti de la puissance des réseaux de neurones profonds, tels que les réseaux récurrents (RNN), les LSTM et les Transformers, pour apprendre les représentations sémantiques et traduire les phrases. La NMT a révolutionné le domaine de la TA en raison de sa capacité à gérer le contexte et la cohérence de manière beaucoup plus efficace que les approches antérieures. Les modèles NMT sont capables d’apprendre des nuances subtiles et des relations complexes entre les mots, ce qui se traduit par une amélioration significative de la qualité de la traduction.
Par exemple, la phrase « The spirit is willing but the flesh is weak » est un proverbe anglais difficile à traduire littéralement. La NMT, ayant appris à partir de vastes corpus de textes, peut identifier qu’il s’agit d’une expression idiomatique et proposer une traduction appropriée dans la langue cible, comme « La volonté est forte, mais la chair est faible » en français. Cependant, la NMT nécessite une puissance de calcul importante et peut être délicate à interpréter. Le fonctionnement interne des modèles neuronaux est souvent perçu comme une « boîte noire », ce qui rend difficile de comprendre comment ils prennent leurs décisions de traduction. De surcroît, la NMT est vulnérable aux données d’apprentissage biaisées, ce qui peut entraîner des traductions inéquitables ou erronées.
- Fonctionnement : Utilisation de réseaux de neurones profonds pour apprendre les représentations sémantiques.
- Avantages : Nettement meilleure qualité de traduction, gestion améliorée du contexte.
- Inconvénients : Exige une puissance de calcul significative, effet « boîte noire ».
Les composantes du TLN essentielles à la TA
Le Traitement du Langage Naturel (TLN) est un domaine multidisciplinaire qui englobe un large éventail de techniques et d’outils permettant aux ordinateurs de comprendre, d’interpréter et de générer le langage humain. Divers éléments du TLN sont essentiels pour la traduction automatique, car ils contribuent à la qualité, à la précision et à la fluidité des traductions. L’efficacité de ces composantes est cruciale pour métamorphoser un texte source en une traduction significative dans une autre langue. Explorons ensemble les principaux composants du TLN qui jouent un rôle déterminant dans la TA.
Tokenisation et segmentation
La tokenisation et la segmentation sont les phases initiales du traitement d’un texte. La tokenisation consiste à diviser le texte en unités plus petites, appelées tokens, pouvant être des mots, des symboles ou des ponctuations. La segmentation consiste à diviser le texte en phrases ou en segments significatifs. Une tokenisation et une segmentation appropriées sont cruciales pour une analyse précise du texte et pour une traduction de qualité. La tokenisation affecte directement la précision avec laquelle le système identifie les mots et leur signification. Sans une segmentation correcte, les phrases peuvent être mal comprises, ce qui conduit à des traductions erronées. La tokenisation et la segmentation préparent le terrain pour toutes les analyses linguistiques ultérieures.
Dans les langues agglutinantes telles que le turc ou le finnois, où les mots sont formés en ajoutant de multiples suffixes, la tokenisation est particulièrement ardue. Les approches récentes du TLN utilisent des techniques de segmentation plus sophistiquées, telles que le Byte Pair Encoding (BPE), pour gérer la complexité de ces langues. Ces techniques autorisent la division des mots en sous-unités plus petites, ce qui facilite l’apprentissage des modèles et améliore la qualité des traductions.
Analyse morphologique et syntaxique
L’analyse morphologique et syntaxique permet de décrypter la structure interne des mots et des phrases. L’analyse morphologique consiste à identifier les parties constituantes d’un mot, telles que sa racine, son préfixe et son suffixe, et à déterminer sa catégorie grammaticale (nom, verbe, adjectif, etc.). L’analyse syntaxique consiste à étudier la structure grammaticale d’une phrase et à identifier les relations entre les mots. Cette analyse est capitale pour appréhender le sens de la phrase et pour produire une traduction grammaticalement correcte. Une compréhension précise de la structure syntaxique autorise la résolution des ambiguïtés et le choix de la traduction appropriée. L’analyse morphologique et syntaxique sont des étapes cruciales pour une traduction de qualité.
Par exemple, la phrase « Le chat mange la souris » possède une structure syntaxique simple : sujet (le chat), verbe (mange), complément d’objet (la souris). L’analyse syntaxique permet de déterminer que « le chat » est le sujet de la phrase et que « la souris » est l’objet du verbe. Cette information est essentielle pour générer une traduction correcte dans une autre langue. L’analyse syntaxique est particulièrement importante pour les langues dont l’ordre des mots diffère, comme le japonais ou le turc. L’analyse syntaxique permet de déterminer la fonction grammaticale de chaque mot et de les réorganiser correctement dans la langue cible. La complexité de l’analyse syntaxique requiert des algorithmes sophistiqués et des ressources linguistiques importantes.
Représentation sémantique (word embeddings, sentence embeddings)
La représentation sémantique consiste à représenter le sens des mots et des phrases sous forme numérique. Les word embeddings sont des vecteurs numériques qui représentent les mots dans un espace sémantique, de sorte que les mots ayant des sens similaires se situent à proximité les uns des autres. Les sentence embeddings sont des vecteurs numériques qui représentent le sens des phrases dans un espace sémantique. Ces représentations permettent aux modèles de TA de saisir les relations entre les mots et les phrases et de générer des traductions plus justes et plus fluides. La qualité de la représentation sémantique exerce une influence directe sur la qualité de la traduction. La représentation sémantique autorise la saisie des nuances et des subtilités du langage humain.
Les embeddings contextualisés, tels que BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) et RoBERTa (Robustly Optimized BERT Pretraining Approach), ont profondément modifié la représentation sémantique. Ces modèles prennent en compte le contexte dans lequel un mot apparaît pour générer un embedding spécifique à ce contexte. Cela rend possible une meilleure saisie des nuances du sens et une gestion plus efficace de l’ambiguïté. Par exemple, le mot « banque » peut avoir deux sens distincts : un établissement financier ou le bord d’une rivière. Les embeddings contextualisés permettent de différencier ces deux sens en fonction du contexte.
Attention mechanism et transformers
Les mécanismes d’attention et les Transformers sont des architectures de réseaux neuronaux qui ont permis d’améliorer considérablement la qualité de la traduction automatique. Le mécanisme d’attention donne la possibilité au modèle de se concentrer sur les parties les plus pertinentes du texte source lors de la traduction. Les Transformers, basés sur le mécanisme d’attention, autorisent le traitement simultané des mots, ce qui accélère le processus de traduction et rehausse la qualité des résultats. Les Transformers ont supplanté les architectures récurrentes (RNN) et LSTM, plus lentes et moins efficaces pour gérer les phrases longues. Les mécanismes d’attention et les Transformers ont rendu possibles des progrès notables dans le domaine de la TA. La complexité de ces modèles requiert une puissance de calcul importante.
Par exemple, lors de la traduction de la phrase « Le chat noir dort sur le tapis rouge », le mécanisme d’attention permet au modèle de se concentrer sur les mots « chat », « noir », « dort », « tapis » et « rouge » pour générer une traduction précise dans la langue cible. Le mécanisme d’attention établit des liens entre les mots de la phrase source et la phrase cible, ce qui permet de saisir les relations sémantiques et grammaticales. Les Transformers, en traitant les mots simultanément, permettent de générer des traductions plus fluides et plus naturelles.
Défis et limites actuelles de la traduction automatique basée sur le TLN
Bien que le Traitement du Langage Naturel ait considérablement amélioré la traduction automatique, il subsiste de nombreux défis et limites à surmonter. Les systèmes de TA actuels rencontrent des difficultés à gérer les idiomes, les expressions figées, les langues rares, les biais, la compréhension du contexte et de l’intention de l’auteur. Ces défis nécessitent des recherches continues et des innovations technologiques visant à rehausser la qualité et la fiabilité de la traduction automatique. Une prise en compte des aspects culturels et sociaux est également essentielle pour garantir des traductions justes et équitables. L’objectif est de développer des systèmes de TA capables de décrypter et de traduire le langage humain avec une finesse et une exactitude comparables à celles d’un traducteur humain.
Gestion des idiomes et des expressions figées
Les idiomes et les expressions figées représentent un défi majeur pour la traduction automatique. Ces expressions présentent un sens qui diffère de la somme des sens de leurs mots individuels. Les systèmes de TA éprouvent souvent des difficultés à identifier ces expressions et à les traduire correctement. Une traduction littérale peut donner lieu à un résultat absurde ou incompréhensible. Il faut pouvoir identifier l’idiome et le remplacer par un équivalent dans la langue cible, ce qui suppose une connaissance approfondie des deux langues et de leurs cultures respectives. La gestion des idiomes et des expressions figées reste un domaine de recherche actif dans le domaine de la TA. Les idiomes varient considérablement d’une langue à l’autre et sont souvent liés à des contextes culturels spécifiques.
Par exemple, l’idiome français « se noyer dans un verre d’eau » signifie se laisser submerger par des difficultés mineures. Une traduction littérale en anglais serait dénuée de sens. Il faut donc trouver un équivalent anglais, tel que « to make a mountain out of a molehill ». La difficulté réside dans le fait que les idiomes sont souvent subtils et peuvent avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Les systèmes de TA doivent être capables de différencier les divers sens d’un idiome et de choisir la traduction appropriée. L’intégration de connaissances du monde réel et de bases de données d’idiomes peut contribuer à améliorer la gestion de ces expressions.
Traduction de langues rares et de données limitées
La traduction de langues rares et de données limitées constitue un défi de taille pour la TA. Les modèles de TA nécessitent de vastes quantités de données d’apprentissage pour acquérir les relations entre les langues. Pour les langues rares, ces données sont souvent limitées, ce qui se traduit par une qualité de traduction moindre. Il faut donc concevoir des techniques visant à perfectionner la TA pour les langues rares en utilisant le transfert d’apprentissage, la génération de données synthétiques ou la traduction zero-shot. La traduction zero-shot consiste à traduire entre deux langues sans disposer de données d’apprentissage directes entre ces deux langues. Les langues rares représentent une part importante de la diversité linguistique mondiale, et il importe de mettre au point des systèmes de TA capables de les traduire avec exactitude et efficacité.
Les techniques de transfert d’apprentissage consistent à utiliser les connaissances acquises lors de l’apprentissage sur une langue riche en ressources pour améliorer la performance sur une langue rare. La génération de données synthétiques consiste à créer des données d’apprentissage artificielles pour la langue rare en utilisant des techniques de modélisation linguistique. La traduction zero-shot consiste à utiliser des modèles multilingues pour traduire entre deux langues sans avoir de données d’apprentissage directes entre ces deux langues. Ces techniques permettent de bonifier de manière significative la qualité de la TA pour les langues rares.
| Type de Langue | Quantité de Données d’Entraînement Disponible | Qualité de la Traduction Automatique |
|---|---|---|
| Langues Riches en Ressources | Très grande | Elevée |
| Langues à Ressources Moyennes | Modérée | Moyenne |
| Langues Rares | Limitée | Faible |
Biais et équité
Les biais présents dans les données d’apprentissage peuvent exercer un impact significatif sur la traduction automatique. Les modèles de TA peuvent apprendre ces biais et les reproduire dans leurs traductions, ce qui peut donner lieu à des résultats inéquitables ou discriminatoires. Il est donc essentiel de déceler et d’atténuer ces biais pour assurer l’équité de la TA. Les biais peuvent concerner le genre, la race, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, etc. Il faut être conscient de ces biais et de leurs conséquences potentielles.
Par exemple, si les données d’apprentissage contiennent un biais de genre selon lequel les infirmières sont toujours des femmes et les médecins toujours des hommes, le modèle de TA risque de traduire de manière incorrecte les phrases qui contredisent ce biais. De même, si les données d’apprentissage véhiculent des stéréotypes raciaux, le modèle de TA risque de reproduire ces stéréotypes dans ses traductions. Les biais peuvent également se manifester dans le choix des mots et des expressions utilisés pour décrire différents groupes de personnes. L’une des solutions pour éviter cela est d’utiliser des données d’apprentissage équilibrées et représentatives. De plus, des algorithmes spécialement conçus pour atténuer les biais sont également en développement. Ces approches permettent de corriger les distorsions et d’améliorer l’équité des résultats de la traduction. Il est essentiel de promouvoir une IA responsable en intégrant des considérations éthiques dès la conception des systèmes de traduction.
| Type de Biais | Exemple de Manifestation dans la Traduction Automatique | Conséquences Potentielles |
|---|---|---|
| Biais de Genre | Traduction automatique d’une phrase neutre en genre vers une langue qui exige l’identification du genre, en attribuant un genre stéréotypé. | Renforcement des stéréotypes de genre et discrimination. |
| Biais Racial | Utilisation de termes péjoratifs ou stéréotypés pour décrire certains groupes raciaux. | Discrimination et marginalisation. |
| Biais Culturel | Interprétation incorrecte ou offensante de références culturelles. | Malentendus interculturels et offense. |
Compréhension du contexte et de l’intention
La compréhension du contexte et de l’intention de l’auteur représente un défi considérable pour la TA. Les systèmes de TA éprouvent souvent des difficultés à saisir le sens profond du texte, les nuances, les sous-entendus et les objectifs de l’auteur. Il faut donc mettre au point des modèles capables de mieux appréhender le contexte général du texte, les connaissances du monde réel et l’intention de l’auteur. Cela passe par une intégration de connaissances du monde réel dans les modèles de TA et un perfectionnement des capacités de raisonnement et d’inférence des modèles. La compréhension du contexte et de l’intention est essentielle pour produire des traductions précises, fluides et naturelles. Un texte dépourvu de contexte peut être mal interprété et mener à des traductions erronées.
Par exemple, une phrase comme « Je suis fatigué » peut revêtir différentes significations en fonction du contexte. Elle peut exprimer une simple sensation de fatigue physique, un ras-le-bol émotionnel ou une volonté de mettre un terme à une conversation. Les systèmes de TA doivent être en mesure de différencier ces différents sens en fonction du contexte et de l’intention de l’auteur. Pour cela, on peut enrichir les modèles de connaissances encyclopédiques et de règles de communication, permettant ainsi de mieux interpréter les signaux implicites. Par ailleurs, le recours à des techniques d’analyse des sentiments et de détection des émotions peut également aider à mieux cerner l’état d’esprit de l’auteur et à adapter la traduction en conséquence.
L’avenir de la traduction automatique et du TLN
L’avenir de la Traduction Automatique (TA) et du Traitement du Langage Naturel (TLN) s’annonce riche en promesses, avec de nombreuses perspectives d’amélioration et de nouvelles applications potentielles. Les recherches actuelles s’orientent vers l’intégration de connaissances du monde réel, le perfectionnement de la gestion de l’ambiguïté et de l’inférence, la conception de modèles plus interprétables et la synergie entre la TA et la post-édition humaine. L’objectif est de concevoir des systèmes de TA capables de décrypter et de traduire le langage humain avec une exactitude, une fluidité et une sensibilité culturelle comparables à celles d’un traducteur humain. L’avenir de la TA est étroitement lié aux avancées du TLN et à la capacité de ces technologies à s’adapter aux besoins et aux défis du monde réel. La collaboration internationale, l’échange de données et le partage des connaissances seront autant d’éléments clés pour accélérer le développement et le déploiement de ces technologies à l’échelle mondiale.
Pistes d’amélioration du TLN pour la TA
Plusieurs voies d’amélioration du TLN peuvent contribuer à parfaire la qualité et la fiabilité de la TA. L’intégration de connaissances du monde réel (Knowledge Graphs) donnerait la possibilité aux modèles de mieux saisir le contexte et de faire des inférences plus précises. Une meilleure gestion de l’ambiguïté et de l’inférence donnerait aux modèles la capacité de résoudre les ambiguïtés et de comprendre les sous-entendus. La mise au point de modèles plus interprétables rendrait possible une meilleure compréhension du raisonnement des modèles et la détection des erreurs et des biais. L’utilisation de données d’apprentissage plus diversifiées et représentatives permettrait d’atténuer les biais et d’améliorer la généralisation des modèles. L’amélioration des algorithmes de tokenisation et de segmentation donnerait la possibilité de mieux gérer les langues complexes et les erreurs d’orthographe.
- Intégration de connaissances du monde réel (Knowledge Graphs).
- Gestion affinée de l’ambiguïté et de l’inférence.
- Conception de modèles plus interprétables.
Synergie entre TA et Post-Édition humaine
La synergie entre la TA et la post-édition humaine représente une approche prometteuse pour bonifier la qualité et l’efficacité de la traduction. La TA peut être utilisée comme un outil permettant d’assister les traducteurs humains, en automatisant les tâches répétitives et en accélérant le processus de traduction. La post-édition humaine consiste à réviser et à corriger les traductions générées par la TA afin de garantir leur qualité et leur exactitude. Cette approche rend possible la combinaison des avantages de la TA (vitesse, efficacité) et de la traduction humaine (précision, sensibilité culturelle). La post-édition humaine est particulièrement importante pour les textes sensibles ou techniques, où l’exactitude est capitale. La collaboration entre l’homme et la machine permet d’optimiser le processus de traduction et d’assurer des résultats de qualité.
La TA peut servir à produire une première mouture de la traduction, que le traducteur humain peut par la suite réviser et corriger. Le traducteur humain peut se concentrer sur les aspects les plus complexes de la traduction, tels que la gestion des idiomes, des expressions figées et des nuances culturelles. La post-édition humaine permet également de vérifier la cohérence terminologique et le respect des normes de qualité. Enfin, l’analyse des erreurs les plus fréquentes permet d’améliorer continuellement les performances des systèmes de TA, créant ainsi un cercle vertueux d’amélioration continue.
Applications futures de la TA
Les applications futures de la TA sont nombreuses et variées. La TA pourrait être utilisée pour faciliter la communication interculturelle, l’éducation, la recherche, le commerce et le tourisme. La TA pourrait aussi servir à démocratiser l’accès à l’information et à la culture, en permettant à des personnes de décrypter et de participer à des conversations dans des langues qu’elles ne maîtrisent pas. La TA pourrait en outre être utilisée pour surveiller les médias sociaux et les forums en ligne afin de déceler les discours haineux, la désinformation et les menaces à la sécurité publique. On peut aussi imaginer des applications dans le domaine de la santé, permettant aux professionnels de la santé de traduire automatiquement les dossiers médicaux de patients étrangers, facilitant ainsi le diagnostic et le traitement. Enfin, la TA pourrait être un outil précieux pour les forces de l’ordre, en traduisant automatiquement les conversations interceptées, contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité.
- Communication interculturelle.
- Éducation.
- Recherche.
- Commerce.
- Tourisme
- Santé
La collaboration : clé de l’avenir
Le Traitement du Langage Naturel a sans conteste métamorphosé la Traduction Automatique, transformant radicalement la manière dont les machines traduisent les langues. Des approches basées sur des règles rigides aux réseaux de neurones profonds, chaque étape a marqué un progrès significatif en termes de qualité, de fluidité et de précision. Si des défis persistent, notamment en ce qui a trait à la gestion des idiomes, des langues rares et des biais, les perspectives d’avenir s’avèrent particulièrement prometteuses.
La Traduction Automatique, portée par les avancées constantes du Traitement du Langage Naturel, se profile comme un outil puissant pour faciliter la communication interculturelle, l’accès à l’information et la démocratisation de la connaissance. Il est essentiel de poursuivre les recherches et les innovations dans ce domaine, tout en demeurant vigilants quant aux implications éthiques et sociales de ces technologies. La collaboration entre l’être humain et la machine, en particulier grâce à la post-édition humaine, demeure essentielle pour garantir des traductions de qualité, justes et respectueuses des cultures. C’est donc une coopération harmonieuse entre les avancées technologiques et l’expertise humaine qui façonnera le futur de la Traduction Automatique.